"La domination blanche" par Solène Brun et Claire Cosquer
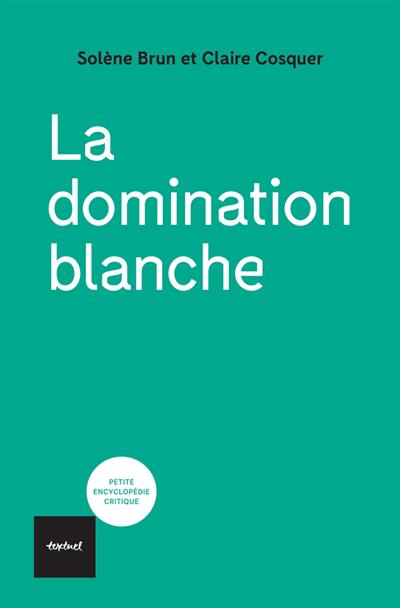
Solène Brun et Claire Cosquer, La domination blanche, Textuel, 2024
S'il n'est pas facile de parler de racisme, au-delà de la dénonciation morale d'un travers jugé individuel, il est encore plus difficile de se pencher, non plus sur les personnes qui subissent des discriminations racistes, mais sur le groupe social qui en tire des avantages : les blancxhes. D'où l'importance de ce petit livre, d'un grand intérêt. Les autrices avaient déjà écrit ensemble un manuel de Sociologie de la race (Armand Colin, coll. 128, 2022), qui donnait tous les outils sociologiques pour appréhender le racisme comme un phénomène social et structurel. Elles poursuivent ici la réflexion, dans un texte à la fois d'intervention et académique, en s'intéressant à cet objet spécifique que sont les blancxhes.
Après avoir rappelé que le racisme n'est pas qu'un ensemble de préjugés individuels ou de discriminations isolées, mais qu'il s'agit bien d'un phénomène social, qui structure l'ensemble de la société, les autrices s'attaquent au groupe des blancxhes. Elles décortiquent le privilège blanc, dont l'une des principales caractéristiques est de se refuser à la conscience : l'identité blanche ordinaire est marquée par son propre oubli. D'où la difficulté à en parler, dans un espace public dominé par les blancxhes. La blanchité se refuse au statut d'objet d'analyse, puisqu'elle se pose en universalité. Les personnes qui en sont exclues sont ainsi les seules à même de voir et de dire cet objet d'analyse.
Il s'agit donc de commencer par montrer qu'il existe une telle chose que la blanchité. C'est un examen historique et sociologique qui permet d'envoyer montrer les contours mouvants.
Il faut passer ensuite de l'existence d'une identité blanche spécifique au constat qu'il existe un privilège blanc. Il ne suffit pas de montrer qu'il existe des blancxhes pauvres pour invalider le concept de privilège blanc, puisque celui-ci ne vise qu'à désigner les inégalités des chances à niveau social égal. Pointer les inégalités dues spécifiquement au racisme ne revient pas à nier les autres. Toutefois, après avoir défendu la pertinence du concept de privilège blanc, les autrices s'attachent à en examiner les limites. S'il permet de montrer que le racisme produit bien des avantages pour les blancxhes, le concept a le défaut d'être statistique (on a ou pas des privilèges) et individuel (les privilèges s'attachent à une personne).
Elles plaident alors pour réfléchir non à ce que les blancxhes en tant qu'individu ont (des privilèges), mais à ce qu'elles sont et ce qu'elles font, en mobilisant les outils de la sociologie dispositionaliste inspirée des travaux de Pierre Bourdieu, et les apports de théoriciens du racisme d'inspiration marxiste, comme Charles Mills (dont le classique Le contrat racial n'a été traduit en français qu'en 2023). Les blancxhes sont alors penséxes comme un groupe social, dont l'individualité est façonnée par leur position dans la structure sociale (habitus blanc), et qui à leur tour agissent et contribuent à reproduire ces structures dont iels tirent avantage, consciemment ou (le plus souvent) non. C'est donc en termes de domination, plus que de privilège, que les autrices nous invitent à analyser le racisme. Dans cette perspective, le dernier chapitre esquisse une analyse des pratiques sociales spécifiquement blanches. FV
<- Article suivant
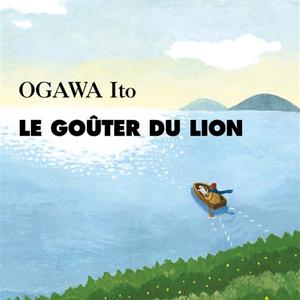
"Le goûter du lion" par Ogawa Ito
Critiques de livre du 13.12.2024
Article précédent ->

"Cuisine soviétique" par Guélia Pevzner
Critiques de livre du 13.12.2024