"La survie des médiocres" par Daniel S. Milo
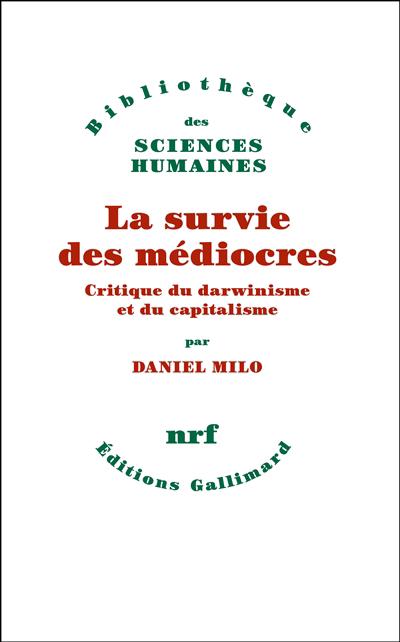
Daniel S. Milo, La survie des médiocres : Critique du darwinisme et du capitalisme, Gallimard, 2024
La survie des médiocres : Critique du darwinisme et du capitalisme. Avec un pareil titre, il peut être judicieux de commencer par dire ce que ce livre n’est pas. Il ne s’agit pas d’un éloge de la médiocrité en tant que telle. Il n’est pas non plus à classer parmi les réfutations de Darwin menées au nom d’un créationnisme obscurantiste et borné. Son auteur, Daniel S. Milo, philosophe, historien, homme de théâtre, a longuement investi le champ de la biologie dans le cadre de ses recherches menées à l’EHESS (École des hautes études en sciences sociales). Au terme d’un long voyage en terres darwiniennes qui a duré une quinzaine d’années, Milo livre ses conclusions dans un ouvrage iconoclaste, pétillant d’intelligence et de drôlerie. Il s’attache à démontrer que l’on peut être un génie comme Darwin, à l’origine d’une révolution scientifique de premier ordre et du paradigme indiscutable de la biologie moderne, et s’être néanmoins beaucoup trompé. Que depuis la disparition du maître en 1882 les darwiniens s’attachent à ignorer ou minimiser ses erreurs. Et que l’alliance objective du néodarwinisme et du néocapitalisme a des conséquences délétères en termes de représentation de l’humain et de la société.
Adhérer au darwinisme, c’est faire siennes deux théories pour le prix d’une : l’évolution et la sélection naturelle. Si la première semble irréfutable, la seconde est nettement plus discutable, pour ne pas parler de son corollaire, la survie du plus apte, si on veut en faire un principe universel. Selon Daniel S. Milo, la sélection naturelle est le péché originel du darwinisme parce que Darwin l’a beaucoup moins déduite de ses observations naturalistes qu’inférée de sa familiarité avec le monde de la domestication et de l’élevage. En d’autres termes, que la prétendue loi de la jungle est en réalité la loi de la ferme.
En dehors de l’élevage et du sport d’élite, l’observation de la nature comme de la société en attestent, ce ne sont pas seulement las champions, qui parviennent à atteindre les objectifs biologiques de base : survivre à son environnement et se reproduire. Y arrivent aussi les un peu moins performants, les médiocres voire les nuls. En alternative à la théorie de la survie du plus apte, Daniel S. Milo propose celle du good enough, du suffisamment bon, en s’inspirant directement du psychanalyste Donald W. Winnicott et sa mère suffisamment bonne, par opposition à l’impossible injonction d’être la meilleure.
Autre idée reçue darwinienne dont l’auteur s’attache à démontrer l’inconsistance, celle de la perpétuelle innovation comme condition nécessaire à la survie. Darwin décrit la sélection naturelle comme un entrepreneur « qui scrute chaque jour et chaque heure, dans le monde entier, les moindres variations, même les plus infimes ; rejetant ce qui est mauvais, conservant et additionnant tout ce qui est bon ». Sans du tout nier l’évidence de la sélection naturelle comme réponse à des situations de crise, il convient aussi de relever le caractère fondamentalement conservateur des organismes et des espèces, qui n’ont aucun intérêt particulier à muter et évoluer, mais qui s’attachent au contraire à reproduire et perpétrer un modèle qui a fonctionné pendant des millions d’années. Outre la sélection, il est avantageux aussi de s’intéresser à la notion de tolérance, d’indifférence, de neutralité naturelles.
Quant à l’idée de la nature comme comptable parcimonieuse, attentive à optimiser ses calculs, à investir un minimum de ressources pour obtenir un gain maximum, ce n’est rien d’autre qu’une fable. Dans la nature comme dans la société, le contre-productif, le disproportionné, l’inefficace, le dispendieux, le gratuit, l’ornemental sans apparente nécessité, existent aussi. Comment expliquer sinon le manifestement trop qui s’exprime à travers la girafe, pourtant considérée comme une des icônes darwiniennes de l’ultra-spécialisation ? Quel besoin avait-elle de grimper jusqu’à six mètres alors que son rival pour atteindre les hauts feuillages, l’éléphant, s’arrête autour des quatre mètres cinquante ? Quelle nécessité y avait-il de la percher sur des pattes de deux mètres de haut qu’elle est incapable de plier, ce qui la contraint à larguer au sol son girafon qui une fois sur deux ne survit pas à l’accouchement ?
Et que dire enfin de l’aberration darwinienne absolue représentée par notre espèce, homo sapiens ? En termes de stricte comptabilité coûts bénéfices, une très longue période de gestation pour accoucher de petits destinés à rester des années dans l’absolue dépendance de leurs parents, couplée à un cerveau incroyablement sophistiqué, mais terriblement énergivore, auraient dû nous vouer à une extinction certaine. MD
<- Article suivant
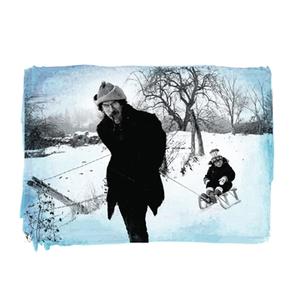
"Alors c’est bien" par Clémentine Mélois
Critiques de livre du 13.12.2024
Article précédent ->

"Chère Dr Mueller" par Cookie Mueller
Critiques de livre du 13.12.2024