"Works" de Vitaliano Trevisan
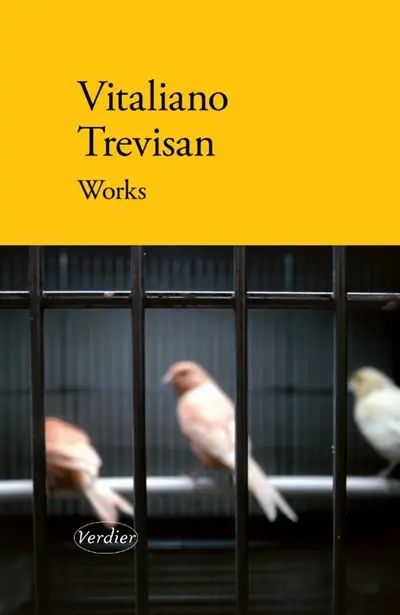
Vitaliano Trevisan, Works, Verdier, 2026. Traduit de l’italien par Martin Rueff et Christophe Mileschi. 736 pages
Avant de pouvoir se consacrer exclusivement à l’écriture ou de travailler pour le théâtre et le cinéma, Vitaliano Trevisan (1960-2022) a exercé pendants vingt-six ans les métiers les plus divers. Parmi lesquels géomètre, dealeur, magasinier, maçon, tôlier-couvreur, dessinateur de meubles, glacier, et tant d’autres. Il s’est contenté d’emplois subalternes ou a occupé des postes à responsabilité. A cette longue traversée est consacré Works, publié en 2016 et enfin traduit en français aux éditions Verdier. Ce roman-monstre de plus de 700 pages occupe une place à part dans la littérature italienne contemporaine. Il frappe d’emblée par la puissance de l’écriture, et par l’intensité de la voix de l’auteur qui se dévoile en homme hypersensible et cabossé. En nous parlant de ce livre, son co-traducteur Martin Rueff s’est déclaré saisi par le contraste entre une «écriture hypersyntaxique» et une langue de la plus grande crudité, volontiers blasphématoire. Et on le verra, la richesse et la précision des informations que le livre contient en font un document exceptionnel sur le monde du travail.
«Un homme est responsable de ce qu’il dit». Trevisan ne parle que de ce dont il a été témoin ou acteur. Il rend compte du monde du travail dans un coin précis, la province de Vicence, en Vénétie, du mitan des années 70 au début des années 2000. (On remarquera à quel point les femmes étaient peu présentes). Au cœur d’un Nord-Est italien industrieux et prospère où, plus encore qu’une valeur, le travail est quasiment une religion. Un mythe, probablement, tempère l’auteur dès les premières pages. Car derrière la légende de la réussite assurée à quiconque aurait simplement «envie de travailler», les zones grises ou noires sont légion.
Parler du travail, c’est relater les règles qui l’encadrent. Et se focaliser si nécessaire sur leur inobservance, relative ou absolue. Trevisan, par exemple, a travaillé plus de dix ans au noir avant de signer son premier contrat de travail de travail en bonne et due forme. Il lui est souvent arrivé d’être engagé d’une simple poignée de main après avoir déclaré que, oui, il avait «envie de travailler». On lui a plus d’une fois versé une partie du salaire ou des primes sous la table. Il a pu observer à quel point, dans les professions dangereuses, le matériel de sécurité était très peu utilisé, car il était lourd, inconfortable, et parce que les autorités responsables de veiller au respect des normes ne surveillaient jamais rien.
Parler de travail, c’est faire état de petites et grandes compromissions, et décrire un gigantesque flux de commissions et de pots-de-vin. Il y a par exemple l’enveloppe représentant un pourcentage précis de la commande reçue que le sous-traitant ne manquera pas de spontanément remettre à titre de remerciement. Il y a ensuite la nécessité absolue d’avoir monnayé ses entrées dans les services d’urbanisme pour qu’une demande d’autorisation de construire ou de rénover soit délivrée dans des délais acceptables. Pour trouver une place, enfin, dans le secteur public, il est indispensable de faire acte d’allégeance à la Démocratie chrétienne, le parti politique qui domine sans partage le vie politique locale. C’est aussi en raison de son intolérance aux lois tacites qui structurent un système profondément corrompu que Vitaliano Trevisan s’est révélé incapable de conserver longtemps le même emploi.
Parler de travail, c’est parler de santé. De ce que le travail fait au corps et à l’esprit des travailleurs. C’est observer l’incroyable raideur du corps d’un vieux maçon. Ou constater qu’en abolissant la notion de jour, le travail de nuit vous plonge en permanence dans un état de demi-veille somnambulique. C’est dénombrer les accidents: «Et bien, que le voyageur sache que, tout comme chaque kilomètre de tunnel ou de viaduc a coûté environ trois ou quatre morts, chaque zone industrielle, ou presque, compte ses morts et ses blessés».
Parler de travail, c’est s’intéresser aux rapports de pouvoir et aux relations de travail. C’est parler de solidarité ou de son absence. De générosité ou de veulerie. De l’obligation de côtoyer des collègues, et de ce qu’il faut endurer d’eux parfois en termes d’haleines chargées d’alcool, d’odeurs fétides, de flatulences. Et de bêtise, hélas: «il existe des individus nettement plus bêtes que la moyenne, qui disent et font toujours et sans cesse des bêtises, et dont la bêtise est constante et si intrinsèquement liée à leur personne qu’il est impossible de séparer l’une de l’autre».
Il y a les boulots que Vitaliano Trevisan a détestés d’emblée. Ceux qu’il a aimés et pour lesquels il a éprouvé un réel intérêt. Sans aller toutefois jusqu’à être enthousiaste, car d’enthousiasme, il l’avoue, il n’a presque jamais été capable. Mais chaque travail, il l’a exercé avec sérieux. Il a fait de son mieux pour le comprendre, pour en maîtriser les gestes, les outils et les procédures, pour en posséder le vocabulaire et la grammaire. Et tout ce bagage acquis est décrit dans le livre avec la plus grande minutie. Mais dans chaque emploi, malgré tout, il a fini par être gagné par la tristesse, par un sentiment d’inadéquation.
Pendant de très longues années, même lorsqu’il n’écrivait pas encore du tout, Vitaliano Trevisan, a été habité par la certitude d’être un écrivain. C’est ce qui lui a permis de rester en vie en dépit de l’insistante tentation du suicide, de son attrait pour les conduites à risque et de son goût des drogues dures. Il était un écrivain n’écrivant pas, qui attendait son heure en lisant beaucoup, Samuel Beckett et Thomas Bernhard en particulier. Avec ce dernier, son modèle assumé, il a en commun une certaine fureur imprécatrice et la détestation d’une bien-pensance satisfaite de soi, hypocrite et provinciale. «Mais qu’est-ce que l’Italie, me suis-je pris à penser en me levant et en m’acheminant vers le Panthéon, sinon un conglomérat de lieux communs. Les prendre à coups de marteau, voilà une de mes tâches».
Et il cogne, à sa manière, en écrivant. Avec la plus haute exigence quant à la chose écrite. En faisant serpenter de très longues phrases, en s’écartant du récit principal par de fréquentes digressions. En précisant, contextualisant, renvoyant dans le texte à l’aide de notes de bas de page, souvent délicieuses. Notes que Trevisan utilise aussi pour tenir un curieux et désopilant décompte des catégories de lectrices et de lecteurs qu’il s’aliène au fur et à mesure en tenant des propos peu amènes. Ou encore pour constater que «ce livre devient de plus en plus compliqué».
(Chronique publié dans Le Temps)
Article précédent ->

Merci!
Actualités du 27.12.2025
Voeux