"Jour de ressac" par Maylis de Kerangal

« J’ai éprouvé un sentiment trouble, nébuleux même, celui d’être l’agent secret de ma propre existence ». C’est dans cette singulière disposition d’esprit que la narratrice de Jour de ressac, le nouveau roman de Maylis de Kerangal, revient un jour de novembre au Havre, ville de son enfance et de son adolescence, où elle a « poussé comme une herbe folle » avant de partir vivre à Paris. Sans doute est-ce pour se tenir au plus près de « l’émotion qu’on éprouve devant ce qui, dans le temps, persévère et se ressemble, devant ce qui avait survécu et que je pouvais reconnaître » que l’autrice, ayant elle-même grandi dans cette ville, a choisi, chose inhabituelle voire inédite chez elle, une narration à la première personne.
Cela commence comme un roman policier : une convocation au commissariat du Havre pour être entendue dans le cadre « d’une affaire vous concernant ». Le corps d’un homme, vraisemblablement lié au narcotrafic, a été retrouvé au pied de la digue, côté plage. Rien ne permet de l’identifier. Seul indice, au dos d’un billet de cinéma, le numéro de téléphone de la narratrice. Celle-ci n’a pas uniquement l’enfance havraise en partage avec l’autrice, mais aussi la propension à s’abandonner « sans réserve au puissant mécanisme créateur d’histoires qui s’active en chacun de nous ». Tout se met à lui faire signe. Comme porté par le ressac, le passé fait brutalement irruption. Des fantômes peut-être, les siens, ceux de la ville, cherchent-ils à lui délivrer un message.
Cet homme sans passé qui semble déposé là par la mer, le connaît-elle, le reconnaît-elle ? Mais c’est quoi, au juste, reconnaître le visage d’un cadavre, réduit par l’absence de regard à rien de plus qu’une face ? Peut-être entrevoir un je ne sais quoi de familier qui, sans pouvoir permettre d’affirmer, ne permet pas d’exclure. Un homme déposé là par la mer ravive en elle le souvenir d’un autre, le même peut-être, comment en être certaine, que la mer a emmené au loin. Craven, son premier amour, qu’elle a connu l’été de ses seize ans. La voilà saisie par la « lubie de l’enquête ».
Comme dans un roman d’espionnage tout est double, à commencer par la profession de la narratrice, doubleuse de cinéma. Enfant déjà, en passant devant les affiches du Channel – la même salle de cinéma d’où provenait le billet portant son numéro de téléphone, où est programmé un cycle sur le film d’espionnage – la narratrice aimait se glisser dans la peau des actrices. Aujourd’hui, dans l’obscurité de la salle de postsynchronisation, elle est troublée de voir à l’écran une autre femme animée par sa propre voix. Il y a les doubles fonds des conteneurs dans lesquels les narcotrafiquants planquent leur marchandise. Il y a une ville derrière la ville, la raffinerie. Il y a sous la ville nouvelle une ville fantôme, rasée en 1944 par des bombardements d’une violence inouïe, réduite à « une matière nouvelle, une substance inédite que la guerre a créée », magma que l’on disait être encore chaud un mois après le déluge de bombes, lave d’animaux, d’éléments architecturaux et de machines, de morceaux humains et d’objets de quotidien.
Pour un travail de lycée, la narratrice avait recueilli le témoignage d’une survivante : stupeur et sidération de qui émerge d’un abri pour constater que plus rien n’est là. A son récit font écho celui de Daria et Ioulia, deux étudiantes ukrainiennes de Kharkiv qui ont trouvé refuge à l’étage du Bar des Sirènes en attente d’un visa pour la Grande-Bretagne, et les pages d’Automne allemand de Stig Dagerman dont la narratrice prépare un enregistrement en livre audio. A l’écrivain suédois, les habitants hagards des villes allemandes demandent la confirmation que la leur a été la plus détruite de toutes, comme la lycéenne affirmait que la sienne avait été la plus martyrisée.
Ce n’est pas un roman policier ou d’espionnage, mais l’évocation intime d’une ville faite essentiellement de nuages, de vent et de vagues. Une ville où les façades rivalisent de gris avec la mer et le ciel. Où, sous la pluie – quand il ne pleut pas c’est qu’il pleuvra – terre et ciel se confondent dans une même pâte grise avant que n’apparaissent, dans une lumière de vitrail, des nuages en forme de barbe à papa. Une énorme vague envoie la narratrice valdinguer et la trempe comme une soupe alors qu’elle marche sur la digue, « pas seulement une force, ou un rythme (…), je pouvais affirmer avec certitude que j’avais eu une relation avec elle : je l’avais appelée », une énorme vague comme venue directement du passé la connecte à une autre vague qui portait l’adolescente irrésistiblement vers Craven. Une ville qui a dans le cliquetis des drisses du port de plaisance son chant des sirènes. Une ville où tout l’annonce, telle une « diva que l’on attend », à commencer par le vol des mouettes – avions nous déjà remarqué combien elles étaient, très précisément, « follettes, gueulardes » ? – mais qui n’apparaît qu’au dernier moment, une fois franchie la Porte Océane : la mer.
Le visiteur se l’imaginait bleue, « quand la nôtre était autre chose, rude, complexe, à la fois pétrolière et impressionniste, prosaïque et rêveuse, parcourue de lignes, de routes, et d’une couleur que pas un seul nom de couleur ne pouvait résorber, d’une couleur qui aurait amplement mérité qu’un nom fût créé pour elle, incluant sa texture, son reflet, son mouvement ». A la fois concrète et lyrique, faisant appel à un lexique d’une grande richesse, du plus familier au plus technique – les mots de l’escrime, sport pratiqué par Maïa, la fille de la narratrice ; ceux de l’imprimerie, la profession de Blaise son compagnon ; ceux, bien sûr, de la mer et da navigation – l’écriture de Maylis de Kerangal est éblouissante. Ses phrases ramifiées, méandreuses, parviennent à faire coexister le passé et le présent, à accumuler les digressions, à empiler les adjectifs sans jamais s’alourdir ni égarer le lecteur, en gardant au contraire un caractère véloce, alerte et bondissant pour toujours retomber sur leur pattes avec la grâce d’un chevreuil. MD
<- Article suivant
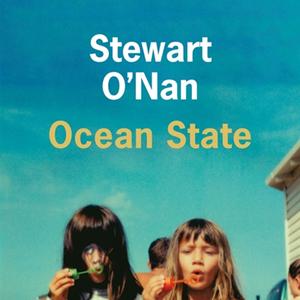
"Ocean state" par Stewart O’Nan
Critiques de livre du 13.12.2024
Article précédent ->
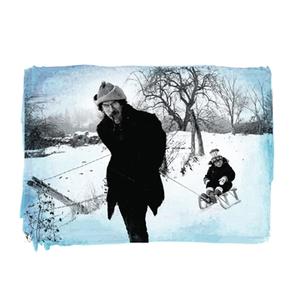
"Alors c’est bien" par Clémentine Mélois
Critiques de livre du 13.12.2024